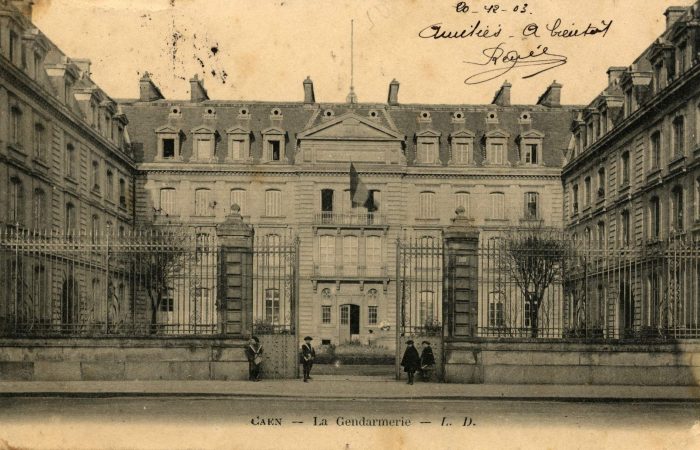Les fortifications de Caen

Le château de Caen.
Crédits : ville de Caen, François Decaëns
En décembre 2014, Rudy Ricciotti dévoilait son projet d’immeuble à côté de la Prairie. Ce projet est la conséquence de la destruction de la caserne Martin pendant l’été 2014. Le même architecte s’est vu confié par la Région l’aménagement du Fonds Régional d’Art Contemporain dans le quartier Lorge, autre caserne située dans le faubourg de la rue Caponière. Cadomus a donc décidé de se pencher sur le lien qui existe entre implantations militaires et opérations d’urbanisme.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, retour sur la genèse de l’architecture militaire à Caen. Au Moyen-Âge et à la Renaissance, la ville de Caen ne possède pas de véritable lieu de garnison. La ville est en revanche protégée par un ensemble de murailles qui s’est développé au cours des siècles.
Première étape : le château. Dressé sur son éperon rocheux, il est doté dès le début de fortifications en bois, puis en pierre. La forteresse est alors composée de deux parties : la résidence ducale, puis royale au nord (salle de l’échiquier, donjon à partir du 12e siècle) et le village entourant l’église Saint-Georges. La division entre ces deux espaces est accentuée au 13e siècle quand Philippe-Auguste, devenu maître de Caen en 1204, fait ceinturer le donjon par une vaste courtine elle-même entourée par un fossé.

Vue d’ensemble du château de Caen.
Crédits : ville de Caen, François Decaëns
En contrebas, la ville ne bénéficie pas d’une véritable muraille. Caen est probablement dotée d’une enceinte dès le 11e siècle, mais son intérêt militaire reste limité car il s’agit au mieux d’une simple levée de terre. Au 13e siècle, quand Jean sans Terre octroie des privilèges communaux à la cité, il est possible que les défenses soient améliorées par l’érection d’une palissade en bois, mais les preuves archéologiques font défaut. Les textes font toutefois référence à des portes. Les choses évoluent véritablement au 14e siècle. En 1346, les Anglais prennent facilement la ville qui est mise à sac. Face à cette menace, décision est prise d’entourer la cité de fortifications dignes de ce nom. Entre 1346 et 1363, est érigé autour de la « vieille ville », c’est-à-dire le Bourg-le-Roi, un mur d’une épaisseur de six à sept pieds, protégé par des fossés ou des cours d’eau. Surmonté d’un chemin de ronde, il est également ponctué par de nombreuses tours rondes ou carrées, avec plate-forme pour l’artillerie. Les liens entre le château et la ville sont également améliorés avec la construction de la porte Saint-Pierre.

Porte Saint-Pierre.
Crédits : Cadomus
Jusqu’alors, l’accès principal au château se trouve au nord, à proximité du donjon jusqu’au 13e siècle et par la porte des Champs. Au sud, il n’existe qu’une simple poterne accessible par les piétons. L’Île Saint-Jean est également protégée par son propre système de remparts. Entre les deux ensembles, un seul point de passage : le Châtelet. Surmontant le pont Saint-Pierre, cette porte fortifiée prenait la forme d’une tour carrée flanquée de quatre tourelles circulaires. Afin de permettre le passage des véhicules, le niveau inférieur était ouvert par des arcades. Au-dessus, se trouvaient des magasins, des lieux de stockage, un corps de garde et un cachot. Ces salles abritaient également l’hôtel de ville. Symbole de la liberté communale, une grande horloge et un carillon y avait été installés. Sur l’horloge, on pouvait y lire la devise de la ville : « un Dieu – un Roy, une Foy – une Loy ». Pour compléter cet ensemble de fortifications, les deux abbayes sont également entourées de murs. Tout ce système n’empêche pas la prise de la ville par les Anglais en 1417. Pendant l’occupation anglaise, les fortifications, endommagées pendant le siège qui dura cette fois-ci deux semaines, sont relevées et le système défensif du château est amélioré (construction de la barbacane de la porte Saint-Pierre).

Barbacane de la porte Saint-Pierre.
Crédits : Cadomus
En 1450, la ville est reprise par les troupes françaises. Quelques améliorations sont apportées au système défensif : deux grosses tours circulaires sont construites pour protéger l’angle nord-ouest (tour Chastimoine à proximité de l’actuel palais de justice) et le flanc nord (tour de Silly).
Troisième et dernière étape : la construction de la courtine des Petits Près au 16e siècle. Entre le Bourg-le-Roi et l’Île Saint-Jean s’étendait un espace non protégé appelé les Petits Près. Les assaillants n’avaient pas manqué d’exploiter cette faiblesse dans le système de défense. Pour y remédier, un mur est construit en 1590 à l’ouest et deux bastions sont élevés à l’endroit où ce nouveau mur rejoint les enceintes historiques : l’un près de la porte Saint-Étienne, appelé bastion des Jésuites à partir du 17e siècle, l’autre dans la Cercle des Jacobins, nommé bastion de la Foire. Cette muraille était percée d’une porte dite porte neuve ou porte des Près et qui occupait l’angle sud-ouest de l’actuelle place Gambetta. Désormais à l’abri des assaillants, le secteur est urbanisé à partir du milieu du 17e siècle (quartier de la place de la République).
Pendant cette période, la ville ne bénéficie pas de lieu de casernement (voir l’article Caen, ville de garnison). La ville est protégée par un système de gué et de milice. Quand des troupes passent dans la ville, elles sont logées chez l’habitant, ce qui n’est pas sans causer quelques désagréments et crispations avec la population locale. À partir du 17e siècle, les hommes en arme sont logés dans les pavillons de la foire (à l’emplacement de l’actuel centre administratif départemental).

Plan des fortifications de Caen entre 1695 et 1713.
Crédits : Gallica
Au 18e siècle, les choses changent. Les enceintes urbaines, devenues obsolètes, sont peu à peu détruites afin d’aérer la ville. Dans le but d’améliorer la circulation sur l’axe Paris-Cherbourg, le Châtelet est démoli en 1755, malgré les protestations de la municipalité qui pourtant ne l’occupait plus depuis deux décennies. À la même époque, l’intendant Fontette fait démolir les fortifications à l’ouest de la ville et combler les fossés. Un vaste projet de réaménagement urbain voit ainsi le jour. À l’emplacement des anciennes fortifications, est aménagée une nouvelle place octogonale articulée sur la place Saint-Sauveur, également en cours de réaménagement. Sur cette nouvelle place, aboutie une nouvelle rue tracée à travers les jardins de l’abbaye aux Hommes, la rue Saint-Benoît (actuellement rue Guillaume le Conquérant), qui devient le principal accès à la ville depuis l’ouest, supplantant ainsi l’antique rue Saint-Martin, trop étroite et trop sinueuse. Dans le même secteur, la tour Chastimoine, de sinistre mémoire, est détruite à la fin des années 1780 pour construire la prison du nouveau Palais de Justice (à son tour détruite en 1906 pour prolonger la rue Bertauld). Plus au nord, les fossés Saint-Julien sont comblés en 1786 pour former une promenade d’agrément plantée d’arbres.

Rempart le long des Fossés Saint-Julien.
Crédits : ville de Caen, François Decaëns
Devant l’abbaye aux Hommes, la destruction des remparts et le comblement des fossés permet également d’aménager une grande esplanade avec jardin à la française. Les destructions se poursuivent au 19e siècle.
Hormis le château, que reste-t-il aujourd’hui de ces fortifications qui ont si longtemps marqué le paysage urbain ? De l’enceinte de l’île Saint-Jean, il ne reste plus rien. La dernière tour conservée, la tour Ès-Morts, a été détruite lors de la bataille de Caen.

Ancienne tour Ès-Morts.
Crédits : collection Georges Pigache
L’enceinte de Bourg-le-Roi a laissé plus de traces : la tour Leroy bien sûr, mais également la tour sur les fossés Saint-Julien dans le collège Pasteur.

Tour Leroy.
Crédits : ville de Caen, François Decaëns
Dans les jardins de la clinique de la Miséricorde, une butte rappelle l’existence d’une tour. Des bouts de mur ont également été préservés : le plus visible se trouve près de l’église Saint-Étienne-le-Vieux et au pied de l’église Saint-Pierre.

Vestiges des remparts proches de l’église Saint-Étienne-le-Vieux.
Crédits : ville de Caen, François Decaëns

Vestiges du rempart du boulevard Saint-Pierre.
Crédits : Cadomus – Karl Dupart
Concernant les deux abbayes, seule l’abbaye aux Hommes a conservé des vestiges de ses fortifications : un long bout de mur, rue de Carel, et une tour, dans une cour rue Lebailly. Enfin, pour voir les dernières traces de la courtine des Petits Près, il faut se faire inviter par madame la Préfète ou monsieur le Préfet ; la butte sur laquelle a été plantée la grande allée d’arbre longeant le boulevard Bertrand en est le dernier vestige.

Tour Puchot, rue du Carel.
Crédits : Cadomus – Karl Dupart